Le Blog Eco de Philippe Jean-Pierre
Articles contenant le tag Economie de La Réunion
J–2 pour la première StartUp WeekEnd à l’Ile de La Réunion | Le Blog de la Ptite Gazette de La Réunion
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Economie de La Réunion, Innovation et R&D, Intelligence territoriale et stratégique, Management, Océan Indien, Prospective et intelligence territoriale le 19 octobre 2011
En partenariat avec la Technopole de la Réunion, avec la Banque de la Réunion, la CCI et SUPINFO se tiendra du 21 au 23 octobre 2011, la première StartUp WeekEnd dans un département d’outre mer.
Vous avez un projet de StartUp mais il vous manque une équipe compétente, ou bien vous avez envie de soutenir et de participer à la création d’une Startup ? Vous devrez, avec votre nouvelle équipe, monter un dossier de startup en 54 heures non stop.
Comment nourrir 9 milliards d’humains sans détruire la planète ? | Eco(lo)
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Aménagement et Urbanisme, Environnement, Innovation et R&D, Océan Indien, Prospective et intelligence territoriale le 14 octobre 2011
Comment nourrir 9 milliards d’humains sans détruire la planète ?
et pour plus de renseignements cf. l’article sur le site de Nature.
L’Economie du Bonheur – The Economic of Happiness by J.D. Sachs
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Analyse économique, Cycle et Reprise, Economie de La Réunion, Océan Indien, Prospective et intelligence territoriale le 29 août 2011
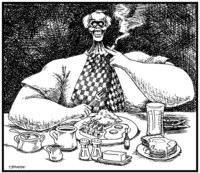 Nous traversons une époque particulièrement tourmentée ; nous vivons dans un monde dont la richesse globale est sans précédent, mais dans lequel l’instabilité, l’agitation et l’insatisfaction occupent également une place de choix. Aux États-Unis, une grande majorité des Américains, de plus en plus pessimistes, pense que leur pays est sur “ la mauvaise voie.” Mais j’ajouterai que tout cela est valable dans bon nombre d’autres pays.
Nous traversons une époque particulièrement tourmentée ; nous vivons dans un monde dont la richesse globale est sans précédent, mais dans lequel l’instabilité, l’agitation et l’insatisfaction occupent également une place de choix. Aux États-Unis, une grande majorité des Américains, de plus en plus pessimistes, pense que leur pays est sur “ la mauvaise voie.” Mais j’ajouterai que tout cela est valable dans bon nombre d’autres pays.
Dans ce contexte, il est nécessaire de reconsidérer nos sources de bonheur les plus substantielles dans le cadre de notre activité économique. La poursuite incessante de la hausse des revenus se traduit davantage par des inégalités et par des incertitudes jamais observées auparavant, que par une croissance du nombre d’hommes et de femmes heureux et satisfaits de leur qualité de vie. Le progrès économique est important, en ce qu’il peut grandement améliorer la qualité de vie, mais seulement s’il est recherché au même titre que d’autres objectifs complémentaires.
pour mieux promouvoir le bonheur, nous devons identifier les nombreux facteurs – autres que le PNB – susceptibles d’élever ou de réduire le niveau de bien-être de la société. La plupart des pays investissent pour mesurer le PNB, mais dépensent peu pour identifier les causes des problèmes de santé (comme le fast fooding et l’excès de télévision), la baisse de la confiance sociale et la dégradation de l’environnement. Une fois que nous comprendrons tous ces facteurs, nous pourrons vraiment agir.
La course aux bénéfices à laquelle se livrent les sociétés est insensée, elle représente une menace pour l’humanité. Il est certain que nous devons soutenir la croissance économique et le développement, mais uniquement dans un contexte plus large, un contexte qui favoriserait le développement durable et des valeurs telles que la compassion et l’honnêteté, nécessaires à la confiance sociale. La poursuite du bonheur ne doit pas s’arrêter au pied des magnifiques montagnes du Royaume du Bhoutan.
17 milliards d’euros d’économies possibles !!!!
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Analyse économique, Crise, Cycle et Reprise, Economie de La Réunion le 23 août 2011
Alors que le gouvernement met la dernière main à un tour de vis budgétaire supplémentaire pour 2012, afin d’assurer les marchés financiers qu’il tiendra bien ses engagements de réduction de déficit public, les services de recherche économique de Natixis publient une sorte de catalogue clé en main des avantages fiscaux à réduire : ce sont ainsi entre 17 et 20 milliards d’euros de rentrées de recettes fiscales potentielles que les économistes de la banque proposent de dégager à travers la réduction des niches fiscales, « sans effets dommageables à long terme sur l’économie française », assurent-ils.
Ecartant les niches fiscales qui répondent à des « considérations culturelles, de justice sociale (handicaps et dépendance…), de sécurité (défense nationale…), d’aménagement du territoire », ils ont conduit leur travail en considérant que ces avantages fiscaux doivent répondre à quatre grands critères :
– cibler en priorité les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et non les secteurs abrités.
– limiter au maximum les effets d’aubaine.
– ne pas participer au soutien de la demande d’un bien ou service si l’offre de ce bien ou service est rigide à court terme.
– ne pas introduire de mauvais signal-prix.
Pour une lecture complète de l’article je vous propose le lien sur le Blog de Philippe Le Coeur : Niches fiscales : 17 à 20 milliards d’euros d’économies, clé en main
Can the Sun Save Reunion Island ? The Interesting Case of Greece Experience !
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Aménagement et Urbanisme, Economie de La Réunion, Innovation et R&D, Intelligence territoriale et stratégique le 20 août 2011
German Finance Minister Wolfgang Schäuble has proposed that developing green-energy resources could be a good way for Greece to generate much-needed economic growth. On paper, it sounds like a perfect solution to the country’s dire fiscal problems: Greece, according to Schäuble, could export solar electricity to Germany.
At first glance, monetizing an abundant natural resource (solar energy) to strengthen the national accounts sounds like a straightforward idea, particular given that electricity in central and northern Europe is becoming more scarce and expensive, owing to Germany’s decision earlier this year to phase out nuclear power. But has Schäuble really found a magic bullet to hold down German electricity prices while restoring economic growth to Greece? Yes and no.
Indeed, the bad news: electricity currently produced in photovoltaic installations is far from price competitive with conventional technologies. “Grid parity”– meaning that the cost of electricity produced by a rooftop solar panel is equal to that of electricity from the wall socket – will only be reached in the middle of this decade.
Even then, solar power will still be more expensive than conventionally produced electricity, because “grid parity” excludes transmission and distribution costs, which typically account for about half of the final electricity price. Moreover, even if solar power were competitive, exporting it to Germany would not make economic sense: the required transmission lines do not exist, and the power losses incurred in transporting electricity over long distances is a disincentive to building them.
Even the reduced need for fuel imports (a quarter of Greece’s electricity is produced from oil and gas) would not have a large impact on the Greek current account. After all, because solar panels are unlikely to be produced domestically, they will have to be imported.
The problem, in a nutshell, is that solar-electricity production does not promise high returns. It is very capital-intensive, and only a relatively small number of jobs would be created (for mounting the panels). Even if Greece were able to produce surplus solar electricity, exports would yield little revenue, because standardized technology means that companies and countries can develop almost no productivity advantage. As soon as solar electricity becomes competitive in Greece, other countries with similar levels of irradiation (Spain, Italy, Portugal, Bulgaria, etc.) will enter the market. This will quickly drive electricity prices towards production cost, as solar-generating capacity in Europe approaches electricity demand.
The best way to ensure that German money and the Greek sun support the development of solar-energy technology would be to implement a European “green certificate system.” Under such a system, every European electricity supplier would have to guarantee that a certain share of the electricity that it sells comes from renewable energy sources. Suppliers’ targets could be differentiated, reflecting countries’ varying potential for deploying renewables or developing renewable-technology industries.
To read the complete text on this interesting subject for Reunion Island, I propose the post of the Author George Zachmann.
Urbanisme et Technologie : Quelle ville connectée pour demain : la ville hybride !
La ville hybride de demain dans laquelle vivront des individus hyper-connectés est une ville en pleine mutation qui sera alimentée par les énergies renouvelables, avec un mode de gouvernance 2.0.
Pour cerner le concept de ville hybride, il faut partir d’un certain individu contemporain (non représentatif de l’ensemble de la société, mais emblématique d’une dynamique sociale).
Il fait tout d’abord preuve d’un double paradoxe. Il est écartelé entre ses aspirations individualistes et son exigence de protection par l’Etat. Il est ensuite désireux de s’impliquer dans différents groupes constitués, tout en exigeant d’être libre de toute attache. Il se caractérise ensuite par sa multiplicité identitaire, dans le but d’éviter la routine d’un seul rôle, et les habitudes qui pourraient limiter son expression personnelle. Il s’agit enfin d’un individu hyper-connecté, doué du don d’ubiquité qui est en relation partout et tout le temps avec ses communautés d’intérêts (avec comme paradoxe l’accroissement du sentiment de solitude).
Pour découvrir davantage la ville connectée de demain ou la ville hybride, je vous propose la lecture de l’article complet.
Pour des économies en développement, le secteur manufacturier doit rester un pilier de la stratégie de croissance
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Cycle et Reprise, Economie de La Réunion, Prospective et intelligence territoriale le 11 août 2011
Nous avons beau vivre dans une ère postindustrielle, dans laquelle les technologies de l’information, la biotechnologie et les services à haute valeur ajoutée sont devenus des moteurs de la croissance économique, la réalité demeure : les pays qui négligent leur secteur manufacturier le font à leur risque.
Le secteur des services de haute technologie exige des compétences pointues et crée peu d’emplois, aussi sa contribution à l’emploi est forcément limitée. Par contre, le secteur manufacturier est en mesure d’absorber de grandes quantités de travailleurs de compétence moyenne, leur procurant des emplois stables et une rémunération intéressante. Les activités manufacturières sont donc, pour bien des pays, une puissante source d’emplois bien payés.
Ce texte de Dani Rodrik, économiste surdoué sur les pas en développement, est intéressant à plus d’un titre pour l’économie de La Réunion. Il nous alerte en effet sur le fait que tout miser sur les nouvelles technologies ou l’économie de la connaissance peut se révéler risqué pour une économie qui se cherche un avenir. Ces secteurs de la nouvelle économie permettront certes de faire participer l’économie réunionnaise à l’économie globalisée mais ils ne lui permettront pas de résoudre ses problèmes d’emplois. Tandis que maintenir un efort sur des secteurs plus tradtionnels ou industriels plus riches en emplois peut s’avérer dans une première phase plus judicieux pour l’économie en question. Avec près de 30 % de chômeurs, et un taux d’emploi faible, La Réunion ne peut se payer le luxe de se tromper de voie.
Afin de parfaire cette analyse je vous propose la lecture du texte de Dani Rodrik : l’impératif du secteur manufacturier !
La chute de la capitalisation boursière : des impacts indirects potentiels et importants sur l’économie réelle ?
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Analyse économique, Crise, Non classé, Prospective et intelligence territoriale le 11 août 2011
L’actualité de ces dernières journées et dernières heures est fortement marquée par l’effondrement des capitalisations boursières. Cette chute des cours et des indices boursiers peut laisser croire à une perte…mais de quelle perte s’agit-il ? Une prise de recul s’impose pour ne pas céder à n’importe quel comportement irrationnel. En fait cette baisse importante des indices se traduit par aucune destruction monétaire mais peut avoir des répercussions indirectes.
Plus précisément, cette situation d’effondrement des bourses implique surtout une crise de confiance qui, si elle ne s’arrête pas immédiatement, peut contaminer l’économie réelle. « Pour citer l’entrepreneur lambda : « il se passe quelque chose, donc j’arrête mes investissements et je licencie… », observe Christian Parisot, chef économiste chez Aurel BGC.
En ce qui concerne, les petits actionnaires, la perte réelle n’est pas forcément estimable ou quantifiable car elle va dépendre des valeurs d’achat et de revente des actions, si ils les revendent. Car sur ce plan, toute baisse non constatée par une vente n’est pas réelle. Il faut savoir faire le dos rond et attendre que la tempête passe. Néanmoins, selon la nature des ménages ou leur localisation géographique, les conséquences sur leurs réactions peut être différentes.
En effet, dans les systèmes nationaux où les retraites sont fondées sur des régimes par capitalisation (par exemple aux Etats-Unis), les ménages peuvent être tentés d’accroître leur épargne et donc de moins consommer en cas d’effondrement des cours qui se poursuivrait. Cela serait alors dommageable à l’économie qui a besoin du ressort de la consommation pour dynamiser sa croissance. Dans les autres systèmes nationaux où les placements en bourses relèvent davantage d’un arbitrage spéculatif ou de support de diversification de son patrimoine (par exemple en France), les petits porteurs, effrayés par tant de crise à répétition, vont alors faire des choix de précaution, quitter la bourse pour se réfugier sur la pierre ou d’autres actifs comme l’or. Cela est déjà le cas puisque plus d’une tiers des petits porteurs français ont déjà quitté la bourse depuis 2008. De plus, l’augmentation des cours de l’or soutien cette tendance même si aujourd’hui la demande d’or relève plus souvent d’acteurs institutionnels. Enfin, ces repositionnement vers la pierre pourraient entrainer une augmentation des prix de l’immobilier ce qui là encore a déjà été observés dans des grandes capitales comme Paris.
Pour les entreprises cotées, qui espéraient pouvoir se financer sur les marchés, cette effondrement même ponctuel est préjudiciable sur le court terme. En effet comment attirer de nouveaux investisseurs devenus plus frileux à l’égard de la bourse. Dès lors, ces entreprises grandes et moyennes vont voir leur capacité de financement direct amoindrie et vont donc reporter certains projets ou augmentation de capital. Là aussi, un autre moteur indispensable à la reprise, l’investissement, va voir son envergure réduite.
Enfin en ce qui concerne les acteurs financiers et institutionnels des places boursières, les effets directs et indirects sont visibles et importants. Par exemple, les valeurs bancaires souffrent énormément touchées par la crise de confiance en le système financier en général, par leur degré variables d’exposition aux dettes publiques des pays européens, par leur capacité variable à se mettre à jour des nouvelles règles dites de Bâle III. Au total, plusieurs banques ont vu leur valeur boursière s’effondrer énormément depuis deux semaines (Société Générale, BNP, Crédit Agricole,…). Il en va de même pour d’autres acteurs institutionnels tels que les fonds d’investissement qui s’appuient en général sur la confiance des investisseurs. Celle-ci étant fortement entamée, ces fonds pourraient voir leur activité être significativement réduite voir paralysée pendant quelques temps. Là encore, ce sont des projets d’investissements qui risquent de ne pas se dérouler.
Au total, on voit que les impacts des chutes des cours sont surtout indirects sur l’économie réelle. Il convient de dire que la sagesse semble être d’attendre que l’orage passe. Mais cela est facile à dire car nous sommes bel et bien au centre d’un conflit entre deux dimensions temporelles divergentes : celles des financiers qui ne peuvent attendre, doivent protéger les portefeuilles de leurs clients et donc faire des arbitrages qui peuvent accélérer la débandade. Celles des investisseurs, pour lesquels la dimension long terme est importante et qui font en général fi des volatilités. Laquelle des deux rationnalités l’emportera, influencera la poursuite du processus de baisse ou son arrêt. Un premier sentiment sur l’avenir est issu des dernières journées de baisse et peut laisser poindre une certaine lueur d’espoir : les trois journées de baisse (vendredi 5, Lundi 8 et Mercredi 10) ont eu des causes différentes…Elles ne participeraient pas d’une lame de fond structurelle sur le marché. La volatilité et l’anxiété sont aujourd’hui les grandes causes du mal (indépendamment des problématiques budgétaires structurelles qu’il faut résoudre et pour lesquelles certains Etats commencent à prendre des engagements douloureux). Les prochaines journées seront décisives pour éclairer sur les capacités de rebond des investisseurs et donc des marchés. Dans cette période de stagflation (faible croissance et inflation) promise, d’austérité attendue, de tensions politiques et sociales prévisibles, les marchés doivent au plus vite réduire leur volatilité excessive et génératrice de surdosages irrationnels.
Petits pays certes…mais peut être grands problèmes…!
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Analyse économique, Crise, Cycle et Reprise, Economie de La Réunion, Prospective et intelligence territoriale le 23 juillet 2011
Le PIB de la Grèce, environ 300 milliards de dollars, représente 0,5% de la production mondiale. Sa dette publique de 470 milliards est considérable, compte tenu de la taille de son économie, mais elle représente moins de 1% de la dette mondiale – et les banques privées (grecques en majorité) en détiennent moins de la moitié. Selon Barclays Capital, seules quelques banques d’envergure internationale détiennent prés de 10% de leurs fonds propres de base en bons du Trésor grec, et la majorité en a bien moins. Aussi, au moins sur le papier, la Grèce n’est pas une économie d’importance systémique. Néanmoins, plusieurs facteurs font que la crise qui la frappe pourrait se propager, et elle n’est pas la seule dans ce cas. Pour étayer cette analyse je vous propose le regard de Kemal Dervis.
Les banques doivent-elles annuler une partie des créances sur la Grèce ?
Posté par Philippe Jean-Pierre dans Actualités, Analyse économique, Economie de La Réunion le 18 juillet 2011
Pour éviter le pire et la contagion…Faut-il un véritable Plan Marshall de la Dette Publique Grecque ? Pour y répondre : Les banques doivent-elles annuler une partie des créances de la Grèce ?



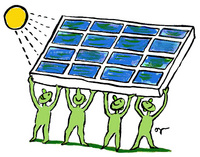
![terreform-blimp-buses_NYC[1]](http://blog.philippejeanpierre.fr/wp-content/uploads/2011/08/terreform-blimp-buses_NYC1-300x246.jpg)
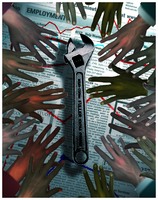



Commentaires récents